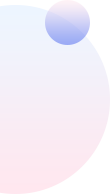Trésors de pierres et d’histoires : les églises rurales de la Beauce Val de Loire
Parmi les paysages à perte de vue de la Beauce ligérienne, de nombreuses églises rurales veillent tels des repères familiers dans la campagne. La Communauté de Communes Beauce Val de Loire (CCBL), qui rassemble plus de 20 communes sur deux...
Lire +