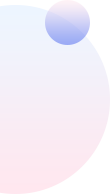La Loire, sculpteur des paysages ligériens
La Loire, avec ses 1 006 kilomètres de longueur, est le plus long fleuve de France. Prenant sa source au Mont Gerbier-de-Jonc en Ardèche, elle sillonne de nombreux territoires avant de se jeter dans l’océan Atlantique. En Beauce...
Lire +