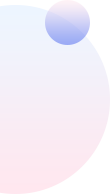Patrimoine bâti : mémoire vivante des campagnes beauceronnes
Dans le paysage paisible de la Beauce Val de Loire, chaque grange, chaque clocher et chaque longère de pierre sont bien plus que des vestiges. Ils racontent, à qui sait les regarder, mille histoires de labeur, d’ingéniosité, et...
Lire +